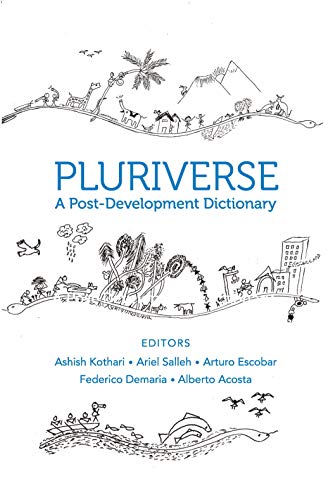Plus de 25 ans après la publication de « The development dictionary », vient de paraître « Pluriverse : a post-development dictionary ». Pourquoi un nouveau livre faisant une analyse critique du concept de développement, qui plus est sous la forme d’un dictionnaire ? Wolfgang Sachs qui a dirigé la rédaction de « The development dictionary » en donne l’explication dans la préface de « Pluriverse » intitulée « le développement revisité » (voir ci-dessous la traduction en français de la préface). Depuis l’émergence du concept à la sortie de la seconde guerre mondiale jusqu’à nos jours, le développement a subi plusieurs mutations, tout en conservant ses fondements les plus néfastes pour l’humanité et l’environnement. Le développement reste porté par l’idée qu’il n’y a qu’une seule forme d’évolution sociale. La « pensée du développement » nie la diversité des sociétés et des territoires et au contraire les soumet à ce que Wolfgang Sachs appelle la dictature de la comparaison quantitative. Le développement désormais affublé du qualificatif de durable est mesuré par des indices économiques mais aussi sociaux. C’est pour prendre en compte ces mutations, analyser leurs effets et proposer des alternatives pour sortir du développement une bonne fois pour toutes, que « Pluriverse » a vu le jour. « Pluriverse » est un dictionnaire sur ce que pourrait être un après développement plus qu’un dictionnaire sur le développement. Et l’après développement ne peut être que pluriel pour la centaine d’auteurs de « Pluriverse » originaires de tous les continents. Le plurivers, « un monde où beaucoup de mondes existent » selon les zapatistes, incarne cette vision plurielle de l’après développement. Le Plurivers est un ensemble d’alternatives au « monde unique » que veulent imposer les puissances impérialistes occidentales. A l’ontologie dualiste du monde unique (une culture universelle agissant sur une nature inerte), s’oppose l’ontologie relationnelle du plurivers (formes diverses de relation des humains entre eux et avec leur environnement dans le respect mutuel). Le plurivers rompt les dualités culture/nature, humain/non humain, homme/femme etc. à l’origine de la crise environnementale et offre par là même des possibilités d’en sortir.
Le livre est composé de 3 parties. Dans la 1ère partie, un auteur de chaque continent fournit une analyse critique des impacts du développement dans sa région. La 2ème partie passe en revue une série d’innovations techniques et financières présentées à tort comme la solution pour sortir de la crise mondiale : économie verte, marché de services écosystémiques, géo-ingénierie, villes intelligentes, transhumanisme… Enfin, la 3ème et principale partie de « Pluriverse » est un recueil des visions du monde et des pratiques, anciennes et nouvelles, locales et mondiales qui émergent des communautés indigènes et paysannes, des périphéries urbaines, des mouvements environnementaux, féministes et sociaux, en marge de la modernité capitaliste : agroécologie, buen vivir, institution des communs, convivialité, décroissance, démocratie directe, droits de l’homme et de la nature, écoféminisme, écosocialisme, souveraineté énergétique et alimentaire, swaraj… Il ne s’agit plus d’appliquer des politiques s’appuyant sur les mêmes mesures et indices de développement partout dans le monde, mais de reconnaître qu’il existe plusieurs chemins pour aller vers un monde durable et juste.
Après l’anglais et l’espagnol, les co-éditeurs de « Pluriverse » (Alberto Acosta, économiste et ancien ministre équatorien de l’énergie et des mines; Federico Demaria, économiste de l’environnement à l’université autonome de Barcelone; Pablo Escobar, anthropologiste à l’université de Caroline du Nord; Ashish Kothari, écologue et co-fondateur de l’ONG indienne Kalpavriksh; Ariel Saleh, sociologue et militante écoféministe) espèrent qu’il sera bientôt publié également en français et dans de nombreuses autres langues.
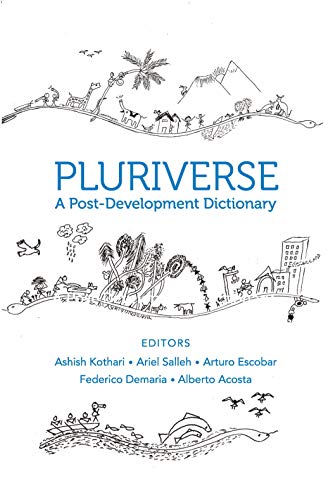
Le développement revisité
Wolfgang Sachs
« L’idée de développement se dresse comme une ruine dans le paysage intellectuel ». C’est ce que nous avons écrit il y a environ vingt-cinq ans, en 1993, dans l’introduction de « The Development Dictionary ». Heureux et un peu naïfs, assis sous le porche de la maison de Barbara Duden près de la Pennsylvania State University à l’automne 1988, nous avons proclamé la fin de « l’ère du développement ». Entre les pâtes, le vin rouge et les rondelles d’oignon, entre les sacs de couchage, un ou deux ordinateurs personnels et de nombreuses rangées de livres, nous avons commencé à élaborer les grandes lignes d’un manuel qui allait exposer l’idée du développement.
Rappelons-nous : dans la seconde moitié du XXe siècle, la notion de développement était comme un puissant souverain sur les nations. C’était le programme géopolitique de l’ère post-coloniale. Comme les dix-sept auteurs, venant de quatre continents, avaient tous grandi avec le concept de développement, nous voulions nous débarrasser des convictions profondément ancrées de nos pères de l’après-guerre. Nous avons compris que le concept avait préparé le terrain pour le pouvoir impérialiste occidental sur le monde. De plus, nous avons senti – plus que pensé de manière rationnelle – que le développement conduisait à un cul-de-sac, dont les conséquences nous toucheraient sous forme d’injustice, de bouleversements culturels et de déclin écologique. En somme, nous nous étions rendu compte que l’idée de développement avait pris une direction qui n’était pas inhabituelle dans l’histoire des idées : ce qui était autrefois une innovation historique est devenue une convention au fil du temps, une convention qui allait se terminer par une frustration générale. Notre mentor spirituel, Ivan Illich, qui était parmi nous, a fait remarquer que cette idée s’inscrirait à merveille dans une archéologie de la modernité qu’il avait l’intention d’écrire. Déjà à l’époque, il était d’avis qu’il fallait parler du développement par le biais d’une notice nécrologique.
Flashback
Quand l’ère du développement a-t-elle commencé ? Dans notre dictionnaire du développement, nous avons identifié le président Harry S. Truman comme le méchant. En effet, le 20 janvier 1949, dans son discours d’investiture, il déclarait que plus de la moitié de la population mondiale venait de « régions sous-développées ». C’était la première fois que le terme « sous-développement », qui allait devenir plus tard une catégorie clé pour la justification du pouvoir, tant international que national, était employé lors d’un évènement politique important. Ce discours a ouvert l’ère du développement – une période de l’histoire du monde, qui a suivi l’ère coloniale, pour être remplacée quelque quarante ans plus tard par l’ère de la mondialisation. Et aujourd’hui, il y a des signes clairs que la mondialisation pourrait être à son tour remplacée par une ère de nationalismes populistes.
Qu’est-ce qui constitue l’idée de développement ? Nous devrions considérer quatre aspects. Sur le plan chrono-politique, toutes les nations semblent avancer dans la même direction. Le temps imaginé est linéaire, ne se déplaçant que vers l’avant ou vers l’arrière ; mais l’objectif de progrès technique et économique est éphémère. Sur le plan géopolitique, les adeptes du développement, les nations développées, montrent aux pays en difficulté la voie à suivre. La diversité étonnante des peuples du monde est ainsi réduite de façon simpliste en nations riches et pauvres. Sur le plan sociopolitique, le développement d’une nation se mesure à sa performance économique, en fonction de son produit intérieur brut. Les sociétés qui viennent de sortir de la domination coloniale sont tenues de se placer sous la tutelle de « l’économie ». Enfin, les acteurs qui font pression pour le développement sont principalement des experts au sein des gouvernements, des banques multinationales et des entreprises. Auparavant, à l’époque de Marx ou de Schumpeter, le terme de développement était utilisé de façon intransitive, comme une fleur qui cherche à éclore. Aujourd’hui, le terme est utilisé de façon transitive comme une réorganisation active de la société qui doit être achevée dans des décennies, voire des années.
Alors que nous étions prêts à chanter l’adieu à l’ère du développement, l’histoire du monde ne nous a pas suivi. Au contraire, l’idée a reçu un nouvel élan. Alors que les premières ébauches de notre dictionnaire étaient prêtes, en novembre 1989, le mur de Berlin est tombé. La guerre froide était terminée et l’époque de la mondialisation a commencé. Les portes pour les forces du marché transnational qui s’étendent jusqu’aux recoins les plus reculés de la planète ont été grandes ouvertes. L’État-nation est devenu poreux ; l’économie et la culture étaient de plus en plus déterminées par les forces mondiales. Le développement, qui était autrefois une tâche de l’État, est maintenant dé-territorialisé. Les sociétés transnationales s’étendent sur tous les continents et les modes de vie sont alignés les uns sur les autres : Les 4×4 ont remplacé les pousse-pousse, les téléphones cellulaires ont remplacé les rassemblements communautaires, la climatisation a remplacé la sieste. La mondialisation peut être comprise comme un développement sans les États-nations. Les classes moyennes mondiales – blanches ou noires, jaunes ou brunes – en ont le plus profité. Elles consomment dans des centres commerciaux similaires, achètent des produits électroniques de haute technologie, regardent les mêmes films et séries télévisées. En tant que touristes, elles disposent librement du moyen décisif de l’alignement : l’argent. En gros, déjà en 2010, la moitié de la classe moyenne mondiale vivait dans le Nord et l’autre moitié dans le Sud. C’est sans aucun doute le grand succès de la « pensée du développement », mais c’est un échec qui se profile à l’horizon.
Effondrement
« Développement » est un mot malléable, un terme vide de signification positive. Néanmoins, il a conservé son statut de perspective, car il est inscrit dans un réseau international d’institutions qui va des Nations Unies aux ONG. Après tout, des milliards de personnes ont fait usage de ce « droit au développement », comme il est dit en 1986 dans la résolution de l’assemblée plénière de l’ONU. Nous, les auteurs du dictionnaire du développement, étions impatients de proclamer la fin de l’ère du développement ; nous n’avions pas anticipé que le coma politique durerait des décennies. Pourtant, nous avions raison – même si nous avions imaginé que cela se déroulerait différemment.
L’effondrement de l’idée de développement est maintenant évident dans le programme de l’Agenda 2030 des Nations Unies pour les objectifs du développement durable (ODD). L’époque où le développement signifiait « promesse » est révolue depuis longtemps. À l’époque, on parlait de jeunes nations aspirant à se lancer sur la voie du progrès. En effet, le discours du développement est porteur d’une promesse historique monumentale : qu’à terme, toutes les sociétés finiront par combler le fossé qui les sépare des sociétés les plus riches et se partageront les fruits de la civilisation industrielle. Cette époque est révolue : la vie quotidienne est désormais plus souvent une question de survie que de progrès. Si la politique de lutte contre la pauvreté a été couronnée de succès à certains endroits, cela fut au prix d’inégalités encore plus grandes ailleurs, et au prix de dommages environnementaux irréparables. Le réchauffement de la planète et l’érosion de la biodiversité ont jeté le doute sur le fait que les nations développées soient le pinacle de l’évolution sociale. Au contraire, le progrès s’est avéré être une régression, car la logique capitaliste à l’oeuvre dans les pays développés ne peut qu’exploiter la nature. Des « Limites de la croissance » en 1972 aux « Limites planétaires » en 2009, l’analyse est claire : le développement en tant que croissance conduit à une insoutenabilité de la planète Terre pour les humains. Les ODD – qui portent le développement dans leur titre – sont une tromperie sémantique. Les objectifs de développement durable devraient vraiment s’appeler OSD – objectifs de survie durable.
Il convient ici de citer un passage du document qui annonçait les ODD : « Il s’agit d’un programme d’une portée et d’une importance sans précédent […]. Il s’agit d’objectifs et de cibles universels qui impliquent le monde entier, les pays développés comme les pays en développement ». Vous ne pouvez pas exprimer plus clairement le changement de mentalité : « la géopolitique du développement », selon laquelle les nations industrielles seraient l’exemple à suivre pour les pays les plus pauvres, a été éliminée. Tout comme l’ère de la guerre froide s’est estompée en 1989, le mythe du rattrapage s’est évaporé en 2015. Rarement un mythe n’a été enterré aussi tranquillement. Quel est l’intérêt du développement s’il n’y a pas de pays que l’on peut qualifier de « développé durablement » ? En dehors de cela, la géographie économique du monde a changé. D’un point de vue géopolitique, l’ascension rapide de la Chine en tant que plus grande puissance économique de la planète a été spectaculaire. Les sept pays nouvellement industrialisés les plus importants sont maintenant économiquement plus forts que les États industriels traditionnels, bien que le G-7 prétende toujours être hégémonique. La mondialisation a presque dissous le schéma Nord-Sud en place.
De plus, le développement a toujours été une construction statistique. Sans le chiffre magique, le produit intérieur brut (PIB), il était impossible de classer les nations du monde. La comparaison des revenus était le point de départ de la réflexion sur le développement. Ce n’est que de cette façon que l’on peut relativiser la pauvreté ou que la richesse d’un pays est déterminée. Depuis les années 1970, cependant, une dichotomie est apparue dans le discours sur le développement, juxtaposant l’idée de développement en tant que croissance à l’idée de développement en tant que politique sociale. Des institutions telles que la Banque mondiale, le Fonds monétaire international (FMI) et l’Organisation mondiale du commerce (OMC) ont continué à ne considérer que l’idée de développement en tant que croissance, tandis que le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), et la plupart des ONG ont mis l’accent sur l’idée du développement en tant que politique sociale. Ainsi le terme « développement » est devenu une expression fourre-tout. Les ODD sont issus de cette tradition. La croissance économique n’est plus l’objectif, mais le réductionnisme de la pensée du développement ne disparaît pas si facilement. Au lieu des chiffres du PIB, nous disposons désormais d’indicateurs sociaux – nutrition, santé, éducation, environnement – afin de cartographier la performance d’un pays. Les données permettent la comparaison, et la comparaison permet de calculer des déficits le long d’un axe du temps, tout comme entre les groupes et les nations. La réduction des déficits dans le monde a été l’objectif du développement durant ces 70 dernières années. En ce sens, l’indice de développement humain, à l’instar du PIB, est un indice de déficit ; il classe les pays de manière hiérarchique et part ainsi de l’hypothèse qu’il n’y a qu’une seule forme d’évolution sociale. C’est ainsi que la pensée du développement révèle son secret : elle vit de la dictature de la comparaison quantitative.
Perspective
L’année même de la publication de notre dictionnaire du développement, un autre livre faisait fureur : La fin de l’histoire de Francis Fukuyama. C’est ce qui a marqué l’atmosphère de l’époque : le triomphe de l’Occident avec sa démocratie et ses conditions de vie industrialisées. Vingt-cinq ans plus tard, en 2018, aucune de ses promesses ne s’est concrétisée. Au contraire, le désarroi, voire le chaos, la peur et la colère se sont largement répandus et contrastent fortement avec le triomphalisme des années 1990. Si l’on devait trouver un mot pour décrire l’atmosphère actuelle dans l’hémisphère nord et dans certaines parties de l’hémisphère sud, ce serait : la peur de l’avenir, la peur que les perspectives de vie se réduisent et que nos enfants et petits-enfants soient moins bien lotis que nous. La suspicion que les attentes suscitées par le développement ne seront pas satisfaites se répand parmi la classe moyenne mondiale. Exclus de leurs traditions, conscients des styles de vie occidentaux à travers leurs smartphones, mais aussi exclus du monde moderne, c’est le sort de trop de gens, et pas seulement dans les pays pauvres. Ainsi, la confusion culturelle et les crises écologiques alimentent la peur de l’avenir.
Quoiqu’il en soit, l’âge moderne expansif s’est enlisé et il est temps d’en sortir. En un coup d’œil, on peut identifier trois récits qui répondent à la peur de l’avenir : les récits de la « forteresse », du « mondialisme » et de la « solidarité ». La « pensée de la forteresse », exprimée par le néo-nationalisme, fait renaître le passé glorieux d’un peuple imaginaire. Les dirigeants autoritaires redonnent de la fierté ; tandis que les autres sont des boucs émissaires – des musulmans à l’ONU. Cela conduit à la haine envers les étrangers, parfois couplés à un fondamentalisme religieux. Une sorte de « chauvinisme d’abondance » s’est largement répandu, en particulier dans les nouvelles classes moyennes dont les biens matériels doivent être défendus contre les pauvres. En revanche, dans le « mondialisme », nous trouvons l’image de la planète comme un symbole archétypique. Au lieu du mercantilisme de la forteresse de « América first », les mondialistes promeuvent un monde de libre-échange idéalement déréglementé, qui a pour but d’apporter la richesse et le bien-être aux entreprises et aux consommateurs du monde entier. L’élite libérale mondialisée peut aussi avoir peur de l’avenir, mais de telles difficultés peuvent apparemment être dépassées grâce à la « croissance verte et inclusive » et aux technologies intelligentes.
Le troisième récit – la « solidarité » – est différent. La peur de l’avenir appelle à la résistance contre les puissants, les garants d’une société du chacun pour soi et la poursuite capitaliste du profit. Au contraire, les droits de l’homme – collectifs et individuels – et les principes écologiques sont valorisés ; les forces du marché ne sont pas une fin en soi, mais des moyens d’atteindre une fin. Comme l’exprime le slogan « penser global, agir local », un localisme cosmopolite se nourrit d’une politique locale qui doit aussi prendre en compte des besoins plus larges. Cela signifie l’élimination progressive du mode de vie impérialiste qu’exige la civilisation industrielle et la redéfinition de formes de prospérité frugale. Selon les mots du Pape François, actuellement l’un des plus importants hérauts de la solidarité avec son encyclique « Laudato Si » :
Nous savons à quel point le comportement de ceux qui consomment et détruisent constamment est insoutenable, alors que d’autres ne sont pas encore capables de vivre d’une manière qui soit conforme à leur dignité humaine. C’est pourquoi le moment est venu d’accepter la décroissance dans certaines parties du monde, afin de fournir des ressources pour que d’autres endroits puissent connaître une croissance saine (§193 du Laudato Si).
J’ai le sentiment que ce dictionnaire de l’après-développement s’enracine profondément dans le récit de la solidarité. Les cent entrées élucident de nombreux chemins vers une transformation sociale qui place l’empathie avec les humains et les non humains au premier plan. Ces visions s’opposent fermement au nationalisme xénophobe et au mondialisme technocratique. Il est très encourageant de constater que la théorie et la pratique de la solidarité, comme en témoigne déjà la diversité géographique des auteurs du dictionnaire, semblent avoir a atteint tous les coins du monde.
Autres ressources
Sa Sainteté, le pape François (2015), Laudato Si’
Illich, Ivan (1993), Tools for Conviviality. New York: Harper & Row.
Mishra, Pankaj (2017), Age of Anger: A History of the Present. London: Allen Lane.
Raskin, Paul (2016), Journey to Earthland: The Great Transition to Planetary Civilization. Boston: Tellus.
Sachs, Wolfgang (ed.) (2010 [1992]), The Development Dictionary: A Guide to Knowledge as Power. London: Zed Books.
Speich-Chassè, Daniel (2013), Die Erfindung des Bruttosozialprodukts: Globale Ungleichheit in der Wissensgeschichte der Ökonomie. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.